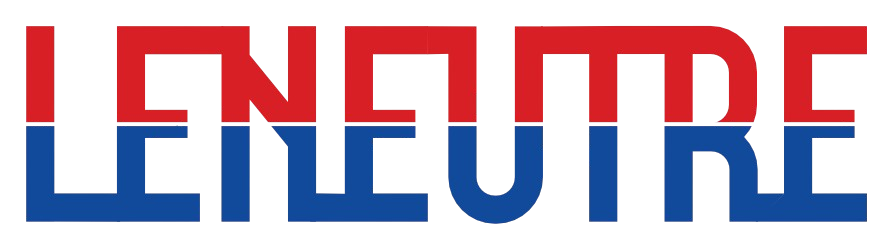Dans le tumulte des marchés locaux, dans les ruelles encombrées des villes africaines, asiatiques ou latino-américaines, et même dans les espaces virtuels des plateformes numériques informelles, les femmes jouent un rôle prépondérant.
CLIQUEZ ICI POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS NOS ARTICLES
Ces actrices de l’économie informelle, animées par une volonté inébranlable de subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté, sont souvent confrontées à des défis structurels qui freinent leur essor. Mais que perdons-nous en ne leur offrant pas un cadre propice à leur développement ?
Une force motrice méconnue
L’économie informelle regroupe des activités génératrices de revenus qui échappent aux réglementations formelles, telles que le commerce de rue, l’artisanat ou encore les services domestiques. Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), les femmes représentent une part significative de cette économie dans les pays en développement, souvent comme travailleuses autonomes ou gérantes de petites entreprises.
Ces femmes contribuent non seulement au revenu de leur foyer, mais aussi à l’économie locale en créant des emplois indirects et en stimulant la consommation. Cependant, leur travail reste marginalisé et sous-valorisé, et elles sont souvent exclues des mécanismes de soutien public et financier.
Les freins à leur épanouissement
La position des femmes dans l’économie informelle est souvent marquée par des obstacles persistants :
Accès limité au financement : Beaucoup de femmes entrepreneuses n’ont pas accès aux crédits bancaires, faute de garanties ou de reconnaissance officielle de leur activité. Ce manque de ressources financières limite leur capacité à investir, à diversifier leurs produits ou à étendre leurs activités.
Absence de protection sociale : Les entrepreneuses informelles travaillent souvent sans couverture sociale, les rendant vulnérables aux aléas de la vie : maladie, accidents, ou perte de revenus.
Reconnaissance institutionnelle faible : Les réglementations ne tiennent pas compte de la contribution des activités informelles, privant les femmes d’un environnement légal qui protège leurs droits et leur permet de prospérer.
Charge mentale et sociale : En plus de leur activité professionnelle, les femmes assument généralement des responsabilités domestiques et familiales qui limitent leur temps et leur énergie pour développer leur entreprise.
Les conséquences pour la communauté
Le manque de soutien aux femmes entrepreneuses dans l’informel a des répercussions bien au-delà de leur propre développement. En les privant d’outils et de ressources, on limite leur capacité à innover, à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie de leur entourage.
Des études montrent que les femmes réinvestissent une grande partie de leurs revenus dans l’éducation, la santé et la nutrition de leur famille. Cela signifie que chaque euro ou franc perdu dans leur activité est aussi une opportunité manquée pour le développement communautaire et intergénérationnel.
Comment réduire le manque à gagner ?
Pour transformer le potentiel des femmes entrepreneuses en levier de développement, plusieurs actions sont envisageables :
Faciliter l’accès au financement : Des programmes de microcrédit adaptés, des plateformes de financement participatif ou des coopératives peuvent donner aux femmes les moyens de renforcer leur activité.
Renforcer la formation : Des ateliers et des formations en gestion d’entreprise, en marketing ou en digitalisation peuvent aider les entrepreneuses à structurer leurs activités et à les rendre plus compétitives.
Améliorer la reconnaissance légale : Intégrer progressivement l’économie informelle dans des cadres réglementaires flexibles permettra de protéger les droits des travailleuses sans alourdir leur fardeau administratif.
Promouvoir la solidarité communautaire : Des réseaux locaux ou régionaux d’entrepreneuses peuvent offrir un soutien mutuel et faciliter l’accès à des marchés plus vastes.
Un avenir prometteur à portée de main
Investir dans les femmes entrepreneuses de l’informel, c’est reconnaître leur rôle de pilier économique et social. C’est leur offrir non seulement des opportunités de croissance, mais aussi les moyens d’épanouir leur potentiel au bénéfice de leurs communautés.
Au-delà des chiffres, soutenir ces femmes revient à nourrir l’espoir d’un avenir plus juste, plus inclusif et plus prospère. Que l’on soit décideur politique, membre d’une ONG ou simple citoyen, la question mérite d’être posée : que faisons-nous pour que cette force vive cesse de manquer à l’appel du développement ?
La Rédaction