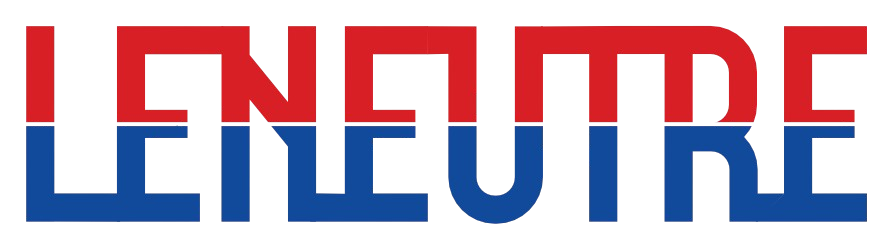Soixante ans après les indépendances proclamées à travers l’Afrique de l’Ouest, une question persiste, dérange, mais revient avec force dans les rues, sur les réseaux, dans les consciences : sommes-nous vraiment indépendants ? Cette interrogation, bien plus profonde qu’un simple débat politique, touche à l’essence même de la souveraineté, de la dignité des peuples, et du droit à l’autodétermination.
CLIQUEZ ICI POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS NOS ARTICLES
Le cas du Togo, petit pays d’Afrique de l’Ouest au passé politique lourd, en est un exemple criant. Car derrière le drapeau flottant, l’hymne national, les présidents élus (ou autoproclamés), et les institutions dites « républicaines », se cachent encore des mécanismes hérités de la colonisation, des dépendances économiques étouffantes, et des influences étrangères profondément enracinées.
Le Togo : un pion ou un acteur ?
Le Togo, ancien protectorat allemand puis colonie française, a obtenu son indépendance en 1960. Mais dès les années 1960, le pays est frappé par l’un des premiers coups d’État de l’histoire post-coloniale africaine, marquant le début d’un long cycle de pouvoir autoritaire sous Gnassingbé Eyadéma, père de l’actuel président.
A LIRE AUSSI : Les étudiants togolais appelés à saisir cette opportunité
Officiellement indépendant depuis plus de six décennies, le Togo peine pourtant à se libérer des structures de dépendance héritées de la colonisation. Qu’il s’agisse de sa monnaie (le franc CFA), de ses relations diplomatiques asymétriques, ou de ses choix économiques souvent téléguidés de l’extérieur, tout semble montrer que la souveraineté togolaise est partielle, fragile, conditionnée.
Le piège du franc CFA : monnaie coloniale ou instrument de stabilité ?
Impossible de parler d’indépendance sans évoquer le franc CFA, toujours en usage dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Togo. Contrôlé en grande partie par la France via le Trésor français, garanti mais aussi limité dans son autonomie, le CFA est vu par de nombreux économistes et activistes comme un outil de contrôle néocolonial.
Même les réformes annoncées ces dernières années, avec la promesse d’une « ECO » régionalisée, semblent davantage relever d’une stratégie de façade que d’un réel transfert de pouvoir monétaire aux Africains.
Tant que le Togo – et d’autres pays – ne pourront pas émettre, gérer et réguler librement leur monnaie, peut-on vraiment parler d’indépendance économique ?
Une économie sous perfusion
L’économie togolaise repose largement sur des exportations de matières premières (phosphate, coton, clinker), et sur des investissements extérieurs majoritairement dirigés par des multinationales ou par des États étrangers. Les décisions stratégiques en matière de développement, de partenariats ou même de fiscalité sont souvent prises en fonction de ce qui est acceptable pour les bailleurs, et non pour ce qui est vital pour le peuple.
La dépendance à l’aide publique au développement, les prêts conditionnés des institutions de Bretton Woods, ou les accords commerciaux déséquilibrés avec l’Union européenne sont autant d’exemples qui montrent que le Togo, comme une grande partie de l’Afrique de l’Ouest, est encore loin d’une autonomie pleine.
Indépendance politique ou dépendance institutionnalisée ?
L’indépendance politique ne se mesure pas uniquement à la tenue d’élections. Elle repose aussi sur l’alternance, la liberté d’expression, la séparation des pouvoirs, et surtout, la capacité d’un peuple à choisir et à changer ses dirigeants librement.
Or, au Togo, cela fait plus de 50 ans que la même famille est au pouvoir. Les élections sont souvent contestées, les voix dissidentes réprimées, et les institutions peinent à jouer leur rôle d’équilibre. Ce déficit démocratique crée un terrain favorable à la manipulation extérieure : plus un État est instable en interne, plus il devient influençable de l’extérieur.
L’Afrique de l’Ouest, terrain de jeu des puissances étrangères
Le Togo n’est pas un cas isolé. La présence militaire française, les bases américaines, l’influence croissante de la Chine, de la Russie ou de la Turquie dans la région montrent à quel point l’Afrique de l’Ouest reste un espace convoité.
Cette compétition géopolitique, souvent masquée sous des projets de coopération, cache mal une réalité : les puissances étrangères ne sont pas là par charité. Elles défendent des intérêts. Et bien souvent, ces intérêts passent avant les aspirations des populations locales.
Repenser l’indépendance, la vraie
Alors, le Togo est-il vraiment indépendant ? L’Afrique de l’Ouest l’est-elle ? Techniquement, oui. Juridiquement, oui. Mais dans les faits, cette indépendance est encore largement théorique. Elle est freinée par des systèmes économiques déséquilibrés, des élites souvent complices ou impuissantes, des modèles politiques verrouillés, et une jeunesse trop souvent mise à l’écart.
Il ne s’agit pas seulement de couper les liens avec l’ancienne métropole. Il s’agit de reconstruire une souveraineté sur tous les plans : économique, politique, culturel, éducatif, technologique. Une indépendance réelle passe par la libération mentale, par l’union des peuples, et par une volonté commune de dire « non » à ce qui aliène, et « oui » à ce qui élève.
L’Afrique de l’Ouest ne pourra s’épanouir pleinement tant qu’elle n’aura pas le courage de se regarder en face et de redéfinir elle-même son destin.
L’indépendance ne se fête pas. Elle s’exerce.
Dimitri AGBOZOH -GUIDIH