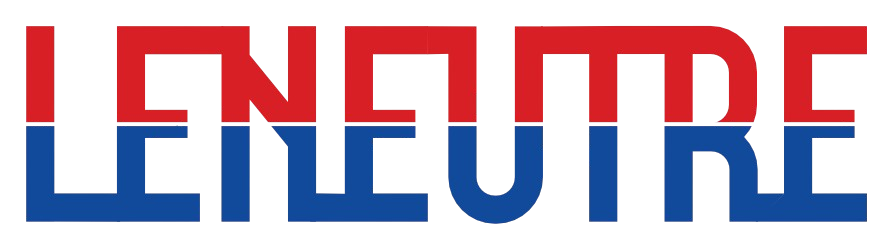Longtemps reléguées aux seconds rôles dans les sphères politiques, les femmes d’Afrique de l’Ouest s’imposent progressivement sur la scène électorale. Dans les rues de Dakar, à la tribune d’Abuja, dans les conseils municipaux de Cotonou ou de Lomé, leur voix résonne avec force.
CLIQUEZ ICI POUR RECEVOIR TOUS LES JOURS NOS ARTICLES
Pourtant, malgré les avancées, la route vers une participation électorale égalitaire est encore semée d’embûches. Dans cette région marquée par des dynamiques socioculturelles complexes, la femme électrice, candidate ou dirigeante demeure à la croisée des traditions, des mutations démocratiques et des luttes féministes.
A LIRE AUSSI : L’UA révèle les raisons du choix de Lomé pour abriter la 1ère conférence sur la dette en Afrique
Pourquoi leur participation aux élections est-elle capitale ? Quelles avancées ont été enregistrées ? Quels freins persistent ? Et surtout, quelles solutions pour une démocratie véritablement inclusive en Afrique de l’Ouest ?
Une participation électorale grandissante, mais inégale
Au fil des décennies, les femmes ouest-africaines ont massivement gagné les rangs des électrices. Selon les commissions électorales nationales, elles représentent souvent plus de la moitié des inscrits sur les listes électorales. Leur mobilisation est remarquable, comme on a pu le voir au Burkina Faso en 2020, au Bénin en 2021 ou encore au Nigéria en 2023. Elles votent, débattent, influencent, s’engagent.
Cependant, cette présence dans les urnes ne se traduit pas encore pleinement dans les urnes de pouvoir. Si certaines femmes arrivent à être élues, elles restent minoritaires dans les assemblées nationales, les mairies et les gouvernements. En 2024, seule une poignée de pays ouest-africains dépassent les 20 % de femmes parlementaires. Le Sénégal, grâce à sa loi sur la parité adoptée en 2010, en est l’exemple le plus emblématique.
Les obstacles persistants à l’engagement politique des femmes
Les normes patriarcales et les rôles de genre figés
Dans de nombreuses sociétés ouest-africaines, la femme est encore perçue comme « gardienne du foyer ». Sortir de ce cadre pour embrasser la vie publique et politique reste souvent mal vu. Les discours stigmatisants, voire misogynes, ne sont pas rares dans les campagnes électorales.
Les freins économiques
Faire campagne est coûteux. Or, les femmes disposent en moyenne de moins de ressources financières que les hommes. Les partis politiques, souvent dirigés par des hommes, allouent aussi très peu de soutien logistique ou financier aux candidates.
Le manque de formation et de visibilité médiatique
Les femmes ont souvent moins accès aux espaces de formation politique. De plus, elles sont peu visibles dans les médias, ou cantonnées à des rôles de « mère de famille » ou « épouse », sans reconnaissance de leurs compétences politiques.
La violence électorale et le harcèlement politique
Des femmes candidates sont régulièrement la cible de campagnes d’intimidation ou de discrédit, parfois jusqu’aux violences physiques ou sexuelles. Cela dissuade nombre d’entre elles de s’engager.
Des avancées notables et des modèles inspirants
Malgré ces défis, des avancées importantes méritent d’être saluées.
Au Sénégal, la loi sur la parité a révolutionné le paysage politique. Les femmes représentent plus de 43 % du parlement.
Au Bénin, des réformes électorales récentes imposent un quota de 24 sièges pour les femmes à l’Assemblée nationale.
Au Togo, des femmes comme Yawa Tségan, présidente de l’Assemblée nationale et victoire TOMÉGAH-DOGBÉ comme premier ministre montrent que le leadership féminin est bien réel.
En Sierra Leone, la loi sur l’égalité des sexes de 2022 garantit au moins 30 % de représentation féminine dans les fonctions publiques et les candidatures électorales.
À l’échelle régionale, la CEDEAO et l’Union Africaine encouragent activement la représentation des femmes, avec des chartes, des recommandations et des mécanismes d’observation électorale sensibles au genre.
Pourquoi leur participation est un enjeu de société ?
Pour une démocratie représentative et inclusive
Les femmes étant la moitié de la population, leur absence dans les instances de décision vide la démocratie de sa substance. Une élection sans femmes est une démocratie amputée.
Pour une meilleure gouvernance
Les études démontrent que les femmes en politique tendent à défendre des politiques plus équitables, à renforcer la transparence, à investir dans l’éducation, la santé, et à promouvoir la paix.
Pour une transformation sociale durable
L’implication politique des femmes a un effet d’entraînement sur l’ensemble de la société : cela change les mentalités, inspire les jeunes filles, et crée une dynamique de progrès dans d’autres secteurs (économie, culture, éducation…).
Quelles solutions pour un avenir plus équitable ?
Renforcer les lois sur la parité et les quotas, avec des mécanismes contraignants.
Créer des fonds d’appui à la candidature féminine, gérés de manière transparente.
Former les femmes dès le plus jeune âge au leadership, via l’école, les clubs de jeunes, les associations.
Assurer une sécurité physique et numérique des candidates contre les violences politiques.
Responsabiliser les partis politiques à intégrer et soutenir activement les femmes.
Faire des médias des alliés, en mettant en lumière les femmes politiques autrement que par leur statut marital ou leur apparence.
Le pouvoir au féminin, une urgence démocratique
L’Afrique de l’Ouest est à un tournant. Les femmes ne demandent plus la permission de participer, elles exigent leur place. Leurs voix, leurs combats, leurs ambitions sont porteurs d’une Afrique plus juste, plus humaine, plus forte.
Les prochaines échéances électorales dans la région seront des tests. L’enjeu ne sera pas uniquement de choisir des dirigeants, mais aussi de mesurer le degré de maturité de nos démocraties. Car une élection sans femmes, ce n’est pas seulement une injustice : c’est un rendez-vous manqué avec l’Histoire.
Dimitri AGBOZOH-GUIDIH